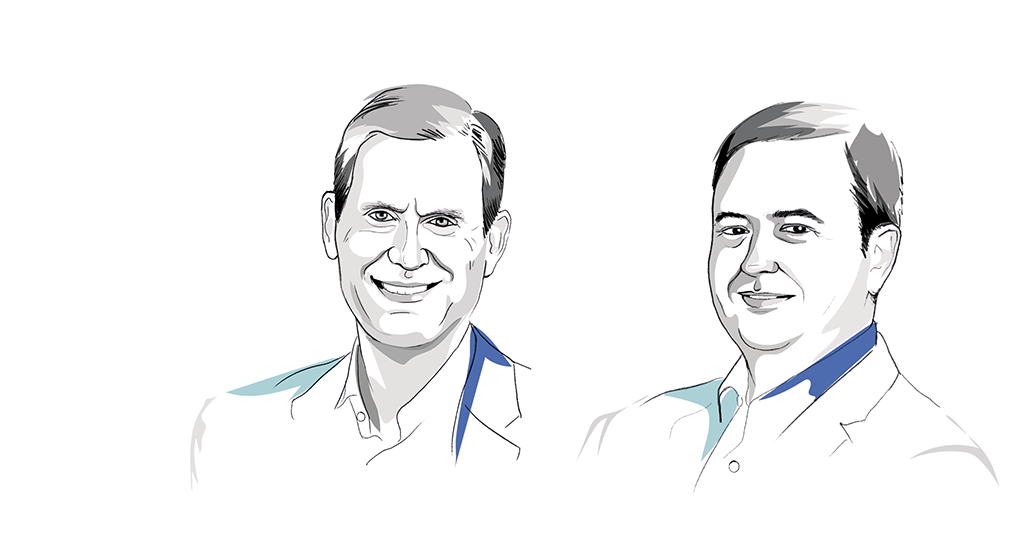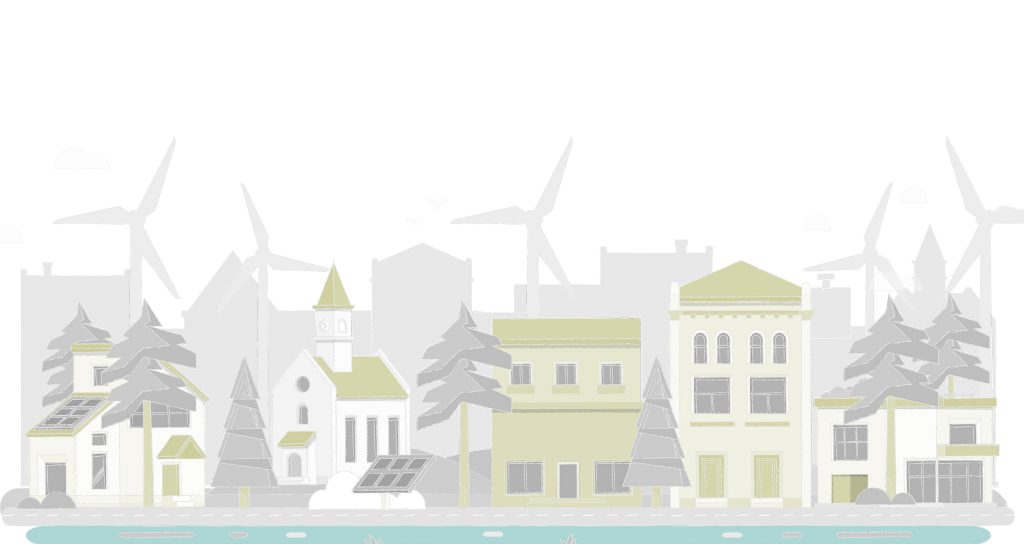Comment comprendre la déstabilisation provoquée par l’émergence des plateformes « rupturistes » dans l’environnement urbain ? Comment dépasser les tensions entre une « pensée magique » de la smart city et la réalité de la ville ? Comment établir le dialogue entre gouvernance et innovation ? Autant de questions soulevées par l’étude Audacities Innover et gouverner dans la ville numérique réelle, publiée en avril 2018. Ses deux auteurs, Thierry Marcou (Fondation Internet nouvelle génération) et Mathieu Saujot (Institut du développement durable et des relations internationales), échangent avec Cécile Maisonneuve, présidente de La Fabrique de la Cité.
Quel est le point de départ de l’étude Audacities. Innover et gouverner dans une ville numérique réelle ?
Thierry Marcou. Pour la Fondation Internet nouvelle génération (Fing), ce travail est le dernier maillon d’une série de chantiers autour de la ville numérique, dont le point de départ a été notre ouvrage La Ville 2.0, plateforme d’innovation ouverte, paru en 2006. Douze ans après, nous avons pensé qu’il serait pertinent de ne pas se contenter d’acter la succession des innovations urbaines et de s’intéresser à ce qui ne marche pas, d’analyser le fossé rapidement creusé entre la promesse lénifiante de fluidité serinée par les start-up et les promoteurs de la smart city, et une réalité urbaine confuse, problématique, chargée de tensions nouvelles issues des pratiques des disrupteurs.
Mathieu Saujot. A l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), nous sommes spécialistes des questions de gouvernance. De son côté, la Fing investit plus spécifiquement les problématiques d’innovation. Ce travail commun était l’occasion de faire dialoguer ces deux champs d’expertise. Sans cette collaboration, nous n’aurions sans doute pas pu, depuis notre seule fenêtre, construire un regard critique pertinent sur la « pensée magique » de la smart city.
Cécile Maisonneuve, cette lecture critique de la smart city et de sa « pensée magique » vous semble-t-elle justifiée ?
Cécile Maisonneuve. Elle est même salutaire ! A La Fabrique de la Cité, nous évitons d’employer le terme de « smart city ». Je constate néanmoins qu’il existe depuis vingt ans. Et ce qui me frappe, c’est qu’alors que le consensus est aujourd’hui établi quant à la nécessité de dénoncer cette « pensée magique », la smart city continue d’alimenter les colloques et les conférences. On a l’impression que, malgré les tensions justement évoquées par Thierry Marcou, malgré la critique largement partagée, le terme de « smart city » résiste, alors qu’il devrait être mort et enterré. Peut-être précisément parce que l’innovation échoue à remplir sa promesse alors qu’en même temps, la situation des villes se détériore et que le besoin de discussion, de débat, demeure très fort.
Remettre en cause le terme de « smart city » n’est pas suffisant. Un élu me demandait récemment : « OK, on renonce à la smart city, mais on la remplace par quoi ? »
M.S. Remettre en cause le terme de « smart city » n’est sans doute pas suffisant. Un élu me demandait récemment : « OK, on renonce à la smart city, mais on la remplace par quoi ? » Sans doute avons-nous besoin de recourir aux concepts – la smart city en est un – pour orienter les discussions.
C.M. C’est une tentative d’appréhender une complexité qu’on a du mal à domestiquer. Il y a derrière ce terme un besoin aigu de narration, d’un récit commun. Le piège, c’est qu’en ayant recours à des notions molles, qui se dilatent très vite, on ne comprend plus ce qu’elles sont censées recouvrir et l’on croit parler de la même chose alors que ce n’est pas le cas. A cet égard, je me demande si la notion de résilience n’est pas en train de prendre le pas sur la smart city comme concept « attrape-tout ».
Au-delà des concepts, ce qui traverse vos travaux, c’est que les « disrupteurs » urbains sont aveugles à la réalité de la ville. Comment l’expliquer ?
C.M. Les startupers sont dans une posture très techno-solutionniste et n’ont généralement pas une culture institutionnelle très développée. C’est assurément un obstacle à l’effectivité de leurs solutions. Car penser la démocratie, c’est penser le temps. Et si l’on n’intègre pas le temps quand on parle de la ville, en tout cas de la ville inclusive, on échoue forcément. Je note également que les grandes plateformes numériques – ces fameux GAFAM – se sont construites sur la même double culture du monopole (quand elles arrivent sur un marché, elles visent non un segment mais tout le marché) et du secret. Bref, à l’opposé exact de la demande sociale, portée vers plus de coopération et de transparence.
M.S. Autant la culture du monopole et du secret peut fonctionner dans le monde virtuel – et les disrupteurs en ont besoin pour crédibiliser leur discours magique –, autant elle devient difficilement tenable dans la ville réelle. Le monopole ne résiste pas aux boucles de concurrence des marchés publics urbains. Quant au secret, il ne tient pas longtemps dans une délégation de service public.
Les startupers sont dans une posture très techno-solutionniste et n’ont généralement pas une culture institutionnelle très développée. C’est assurément un obstacle à l’effectivité de leurs solutions.
Mais cette friction avec le réel, les start-up ne commencent-elles pas tout de même à l’intégrer elles-mêmes ?
T.M. Nous sommes entrés dans Audacities par la disruption, en constatant l’emprise de plus en plus forte des Uber, Deliveroo, Airbnb, Amazon et leur force de frappe financière. Mais la manière dont les choses ont évolué ces derniers mois est assez impressionnante. L’exemple d’Uber est à cet égard éloquent. La start-up s’est d’abord développée sur une posture ultra-disruptive et ultra-exclusive. Aujourd’hui, on la voit passer des accords aux Etats-Unis avec des villes soutenant des transports publics subventionnés, dans l’idée de proposer une offre de mobilité globale. En France, Uber exprime clairement sa volonté de dialoguer avec certaines villes pour proposer une boucle complémentaire à leur offre de mobilité publique. Le dialogue a donc fini par se mettre en place.
C.M. Allez, soyons positifs ! Certes, les plateformes se sont heurtées au réel. Mais elles nous ont également révélé le réel. Par exemple, « grâce » aux Uber et consorts, on ne peut plus dire qu’on ne connaît pas les lacunes et limites de nos systèmes de mobilité, notamment publics. Les plateformes nous placent devant nos propres insuffisances en matière de gouvernance.
T.M. La problématique ne se réduit pas à une équation binaire. D’une part, nous sommes tous – bien qu’attachés aux fondements et aux valeurs de systèmes collectifs – demandeurs de ces services de rupture, y compris quand il s’agit de faire appel à des livreurs à vélo sous-payés. D’autre part, on ne peut pas nier le fait qu’Uber, en Ile-de-France tout du moins, est en train de compléter les manques du réseau de transport public, notamment via le covoiturage. Or, quand on constate à quel point le covoiturage peine à décoller et que l’autosolisme demeure force de loi, que d’occasions perdues à ne pas avoir voulu envisager ces opportunités plus tôt et à s’être crispés sur une posture stigmatisante à l’égard d’Uber et de la menace qu’il faisait peser sur le monopole des taxis !
Les villes ont donc également une part de responsabilité dans la difficulté à établir un dialogue constructif avec les plateformes ?
M.S. Il y a également des freins culturels du côté de la sphère publique. Quand une ville, face à dix start-up spécialisées dans le covoiturage, décide de les soutenir toutes alors que chacune d’entre elles a besoin d’une masse critique pour se développer, on peut parler d’une programmation de l’échec. En Chine, les villes choisissent un champion, un seul, et l’accompagnent pleinement dans son développement. En France, il nous faudrait définir de bons équilibres pour pousser l’innovation tout en garantissant une certaine égalité des chances. Il faudrait que nous soyons capables de dire « voici vers quoi nous voulons aller » et nous donner les moyens d’y aller.
Comment renforcer les opportunités de dialogue entre la gouvernance et l’innovation ?
C.M. S’il y a UN point d’entrée, c’est le politique. Le rôle d’un élu est de donner une vision, de se positionner très clairement sur ce qu’il veut pour sa ville, au-delà des six ans de sa mandature. De ce point de vue, il est intéressant de voir certaines villes – je pense au programme « Bordeaux Métropole 2050 » – se lancer dans des démarches prospectives charpentées, alors qu’en France, la prospective a toujours été la chasse gardée de l’Etat ou des très grandes entreprises.
T.M. Tout à fait d’accord. L’innovation est un sujet politique. Alors débattons. J’attends des candidats qu’ils aient des positions personnelles sur les données, sur la voiture autonome, sur les objets connectés. Reste que pour se départir de la pensée magique et orienter l’innovation, encore faut-il que les acteurs urbains se dotent de méthodologies d’évaluation et de grilles de lecture pertinentes. Il y a ici un important travail d’outillage à engager. On peut aussi réfléchir aux échelles et aux alignements les plus pertinents pour orienter les choix. Après tout, c’est dans le cadre du C40 que des villes européennes se sont coordonnées pour apporter une réponse à Airbnb…